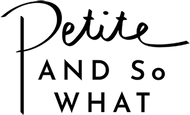Redécouvrons ensemble la vie de cette petite femme d’exception, qui a notamment marqué l’histoire par son engagement indéfectible pour les droits des femmes et la justice sociale. Elue "femme préférée des Français" en 2010 par le sondage de l'IFOP (Institut Français de l'Opinion Publique), Simone incarne la figure d'une féministe engagée, d'un témoin respecté de la mémoire de la Shoa et d'une professionnelle de la politique au parcours atypique.
Les débuts d’une vie marquée par la résilience
Simone Veil est née Simone Jacob, le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive, patriote et laïque. Sa mère, qui n'a pas pu continuer ses études malgré l'obtention de son bac et un début de formation en biologie prometteur, pousse ses filles dans les études. Figure importante dans la vie de Simone, cette femme très éduquée et aimante restera un modèle pour la jeune Simone en construction.
Adolescente, sa vie bascule avec l'occupation nazie. À 16 ans, elle est déportée avec une partie de sa famille au camp d’Auschwitz-Birkenau. Cette expérience, qu’elle portera en silence pendant de nombreuses années, forgera sa conviction que la dignité humaine est une valeur non négociable.
De retour en France après la guerre, Simone reprend ses études et intègre l’Institut d’études politiques de Paris. Elle rencontre Antoine Veil, qu’elle épouse en 1946, et ensemble, ils construiront une vie empreinte de service public. Mais Simone se distingue rapidement par sa propre voix et son engagement personnel.
Une carrière judiciaire salvatrice
En 1956, Simone passe le concours de la magistrature qu'elle réussit haut la main. Elle occupe alors le poste de Haut Fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire et s'attèle dès son arrivée à la tâche colossale d'humaniser les prisons françaises. En plus de rendre compte des mauvais traitements et du manque de matériel, elle s'attache à améliorer le quotidien des femmes. L'écho de ce qu'elle avait subi en déportation l'anime et il est hors de question de ne pas respecter la dignité humaine même en détention. C'est ainsi qu'elle instaure la création de centres médico-psychologiques dans les maisons d'arrêt et impose le passage d'un camion de radiologie. Elle fera aussi ouvrir bibliothèques et structures scolaires pour les mineurs faisant fi des voix qui s'élèvent "contre les prisons trois étoiles".
Avec l'arrivée de la guerre d'Algérie, Simone devient ambassadrice de la protection des droits de l'homme à l'international. De ce fait, elle transfère en France des prisonnières algériennes subissant mauvais traitements et viols ainsi que des hommes menacés de la peine capitale.
Une voix forte pour les droits des femmes
En 1974, Simone est nommée ministre de la santé, faisant d'elle la deuxième femme à devenir ministre de plein exercice depuis 1947. Elle entre dans l’histoire en portant une loi qui allait transformer la société française : la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Dans un hémicycle largement masculin, elle prend la parole avec calme et détermination, malgré les insultes et les attaques personnelles.
Son discours du 26 novembre 1974 est resté gravé dans les mémoires. Elle y affirme :
« Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes pour s’en convaincre. » Cette loi, adoptée en janvier 1975, est une avancée majeure pour les droits des femmes, leur permettant de disposer librement de leur corps.
En plus de cet exploit, Simone continuera de placer la femme au cœur de ses combats, avec notamment la mise en place d'aides financières à destination des mères d'enfants en bas âge. Et même si Simone rejette l'étiquette de "féministe" militante, ses actions parlent d'elles-mêmes. Elle œuvre toute sa vie pour que les femmes puissent accéder aux mêmes droits et aux mêmes opportunités que les hommes. Elle défend la parité en politique et se bat pour une meilleure reconnaissance des femmes dans les sphères de pouvoir.
Un engagement européen et universel
Simone ne s'arrête pas là et en 1979, elle devient la première femme présidente du Parlement européen, affirmant ainsi son rôle de pionnière dans la construction d’une Europe unie et pacifique.
Pour elle, l’Europe n’était pas seulement un projet politique : c’était une réponse au nationalisme et à la barbarie qu’elle avait connus. Elle voyait dans la coopération européenne une manière de préserver la paix et la dignité humaine.
Bien que les premiers mots de son discours d'investiture s'adressent à Louise Weiss remerciant son engagement et ses combats menés pour l'émancipation de la femme. Ces trois grands défis à la tête du Parlement sont les suivants :
- La paix : qu'il faut préserver tant sa fragilité est égale à sa valeur. En maintenant un rapport de force égal envers tous les pays créant l'Europe.
- La liberté : aussi vite acquise que reprise à une époque où le totalitarisme s'étend, ne laissant que l'Europe comme îlot de sa représentation.
- Le bien-être : défini par plus de solidarité envers les pays en difficultés composant l'Europe et une réelle réduction des inégalités.
Simone reçoit en 1981, le prix Charlemagne, décerné pour son engagement en faveur de l’unification européenne. Elle déclare en 2008 « Quand je regarde ces soixante dernières années, l’Europe c’est ce que l’on a fait de mieux. ».
Un héritage intemporel
Simone Veil décède le 30 juin 2017, mais son héritage continue de rayonner. En 2018, elle est entrée au Panthéon, accompagnée de son époux, Antoine Veil. Sur son épitaphe figurent deux mots simples mais puissants : "Justice et Dignité".
Simone a prouvé qu’un seul individu, animé par des principes inébranlables, peut changer le cours de l’histoire. Nous lui dédions ces lignes en hommage à son courage, à son intelligence, et à son humanité qui continue de nous inspirer.
Sources : Info.gouv ; France TV ; Universalis ; Le Monde ; Radio France.